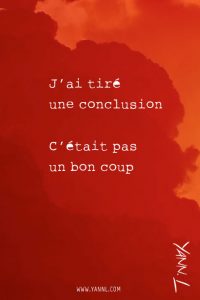Samedi après-midi. Rue Principale. Des tas de gens font des tas de choses. Marchent. Déambulent. Flânent. S’embrassent. Se disputent. Se rencontrent. Se quittent. S’émerveillent. Se désespèrent. S’arrêtent. Continuent. Entrent dans des lieux dont d’autres ressortent. Valse des sacs de papier. Flamenco de la dépense.
Une vieille dame promène son chien. Un jeune homme promène sa fiancée. Une jeune fille particulièrement jolie fait courir sur elle les yeux des passants.
Sur les marches de l’Eglise de trop jeunes toxicomanes s’aveuglent de drogue.
Dans l’Eglise un trop vieux prêtre prie la Madone. Sur le clocher de l’Eglise un jeune corbeau fait sa toilette. Les passants ne voient pas l’Eglise.
Samedi après-midi. Rue Secondaire.
Natan marche. Lentement. Il a le temps. Son regard se promène de vitrines en décolletés, de librairies en galeries, de vendeurs de marrons en diseurs de poésie. L’automne est là. Les feuilles tombent. L’exode des marchands de glaces touche à sa fin. Parfois, au travers d’une vitrine, il en voit encore quelques-uns, attablés derrière un chocolat chaud, leurs valises amoncelées à l’entrée et leur billet d’avion dépassant de la poche de leur pardessus. S’il était venu trois semaines avant – seulement trois semaines – il les aurait tous vus. Ce n’est pas n’importe quoi, l’exode des marchands de glaces. C’est le début de l’hiver vu par l’homme. Même les oiseaux migrent plus tard. C’est bien normal. Pour rien au monde ils ne rateraient la danse des chariots à glace, leur rassemblement sur les bords du lac, puis la longue file marchant silencieusement vers les portes de la ville avant de s’évanouir vers le sud.
Samedi après-midi. Croisement de la Rue Principale et de la Rue Secondaire.
Natan s’arrête un instant. Devant lui le flot humain, canalisé dans cette seule rue par la magie de la publicité. Derrière lui la rue préférée de ceux qui n’ont pas la télé. Natan n’a pas la télé.
Natan hésite. Derrière lui, dans les cafés de la Rue Secondaire, des gens se parlent. Se racontent des histoires. S’échangent des idées. Devant lui, bien que beaucoup plus nombreux, les gens s’entraînent à s’ignorer. C’est le jeu favori des foules. Il n’a jamais vraiment compris quel pouvait en être le but, à supposer qu’il y en ait un. Natan hésite.
A quelques pas de lui, un banc. Inoccupé. Il s’en approche. S’y assied. Sur le dossier, une plaque de cuivre, carte d’identité pour mobilier immobile. “Banc du Croisement de la Rue Principale et de la Rue Secondaire”. De sa poche gauche il extrait une pipe, de la droite une tabatière. Il bourre sa pipe. Lentement. Comme quelqu’un qui hésiterait entre une rue et une autre. L’allume. Le tabac se consume paresseusement, en volutes.
Depuis chez lui, Natan peut voir les corbeaux lustrer leur plumage sur le toit de l’Eglise. Et la nuit, en noir sur noir, la danse folle des chauves-souris jouant à chat autour du clocher.
Il aimerait bien la visiter, l’Eglise. Demander au prêtre sa bénédiction pour monter tout en haut, au-dessus des cloches, là où dorment les noctules, la tête en bas comme pour écouter la terre rêver. Mais il n’ose pas. Alors il reste chez lui et regarde par la lucarne les lumières des candélabres éclairant la Rue Principale.
Son appartement se compose d’une seule pièce. Immense. Au milieu, un piano. Autour du piano, des partitions. Sur les partitions, sa musique.
Natan joue. Depuis toujours. Et les oiseaux l’écoutent.
Ce soir, il est triste. Alors le piano pleure. Des larmes noires, d’autres blanches.
Des notes de musique. Belles comme une mélancolie. Élégantes comme l’absence.
Toute la nuit, la lucarne ouverte, il joue.
L’aube le surprend les bras en croix sur le clavier, endormi, les dernières vibrations de l’instrument berçant son sommeil.
Les saisons passent. Les marchands de marrons s’évaporent à la fonte des neiges, ne laissant de leur passage qu’un rond carbonisé sur le sol.
Avec l’été réapparaissent les marchands de glaces. Toujours plus bronzés, mais toujours moins nombreux. Natan se demande s’ils hésitent à revenir d’où ils vont. Ou si certains ne survivent pas au voyage. Il n’existe hélas aucune statistique sur la vie des marchands de glaces.
Depuis quelques mois, Natan vit une romance musicale. Entendez par là que les mots n’y sont pour rien. Rien du tout. C’est une histoire de portée.
Ils se sont rencontrés par hasard. Sur le Banc du Croisement de la Rue Principale et de la Rue Secondaire. Elle s’appelle Eve, a reçu de son père la chevelure sombre de l’Orient, de sa mère les yeux océan du Nord, de leurs amours le teint sable brûlant du métissage.
Les derniers jours du mois d’avril tissent consciencieusement un écrin de printemps dans les rues encore engourdies d’un trop long hiver. Sur le trottoir d’en face, un marchand de marron, sa femme et leurs deux filles. Les demoiselles s’occupent d’elles-mêmes, l’homme, assis à même le sol, dit au revoir aux pigeons, et la femme, dans son grand manteau de fourrure, charge dans la longue limousine noire les recettes de la saison.
Natan, assis à l’angle nord du banc, les regarde faire. Eve, assise à l’angle sud, regarde Natan les regarder faire.
Cela dure longtemps. Très longtemps. Dix-huit bus jaunes, dix-sept tramways oranges, vingt-trois bicyclettes de couleurs différentes, trois cars de japonais, cinq dealers, six poètes, onze acheteurs d’évasion, une voiture de police et treize hommes-cravates passent entre les deux trottoirs d’en face, avant que, finalement, au passage saugrenu de deux danseurs de tango s’évanouisse la limousine noire, dans les dernières lueurs du jour.
Alors qu’il aperçoit encore, au loin, les yeux rouges du départ, Natan se lève, sort de sa poche un mouchoir. Salue.
Marron qui part, été qui vient.
Un sourcil légèrement relevé, Eve observe son manège.
– Que faites-vous ? Demande-t-elle.
– Je dis au revoir à l’hiver, répond-il.
Sans plus de cérémonie, il se rassoit, bourre sa pipe, sort un bloc et griffonne. Main gauche. Clé de fa. Le reste appartient à l’oreille.
L’encoignure des lèvres d’Eve suit le mouvement de son sourcil, et, d’un long sourire, elle questionne :
– Vous écrivez ?
– Oui.
– Une lettre d’amour ?
– Non.
– Pourquoi ?
En guise de réponse, Natan se lève. Dans sa tête aucun mot, pas de syllabe, pas le moindre commencement de début de phrase. Seules des notes suspendues par leur croche, semblent vouloir s’évader de ses lèvres.
– Vous partez déjà ?
– Oui.
Il fait un pas. A son tour elle se lève. Se met en face de lui. Le fourneau de la pipe les enveloppe d’un nuage de senteurs musquées. Elle pose la main sur son épaule, lance un regard sur les feuilles abandonnées au bout de son bras. Le lui arrache. Se rassoit. Lit.
Natan reste là. Debout. Coi.
Arrivée à la dernière note de la dernière portée, elle le regarde. Espiègle.
Elle revient à la première portée, et, lentement, dessine une clé de sol.
Natan resta là. Debout.
Une à une, des notes s’épanchent. Des notes. Des clés de sol. Des notes, des clés de sol. Soupirs. Sur un poteau électrique, des hirondelles chantent, rythmant de leur ramage l’improvisation d’Eve.
La dernière phrase écrite, elle tend la partition à Natan. Il ne dit rien, la prend par la main. L’enlève.
– C’est grand chez toi. Et l’immeuble est bien calme. On dirait que tu es le seul locataire.
– C’est le cas. Mon père m’a légué le bâtiment pour que je puisse jouer sans importuner les voisins. Il voulait m’offrir une maison à la campagne, mais je n’ai pas voulu. Je n’aime pas trop la campagne. Ca manque de voisinage…
– Paradoxal.
– Pas vraiment.
Il la prend à la taille, l’assied sur le piano, s’enfuit un instant. Revient avec les ingrédients nécessaires au thé et à un feu de cheminée. S’installe sur le tabouret au cuir grinçant, sort leur partition commune de sa poche. Joue.
Elle l’écoute. Ne dit rien. Cela dure longtemps. Très longtemps. Sous elle, Eve sent le piano, la musique, les accords se déclarant comme autant de caresses. Les vibrations, naissant de la pression de Natan sur la touche, viennent mourir sur les généreuses formes de la douce.
Ils communiquent. De bien belle façon.
Soudain, au moment où la nuit s’y attend le moins, elle se met à chanter. Il continue à jouer.
Le temps, mélomane dans l’âme, s’est arrêté. Assis près d’eux, il écoute.
La voix d’Eve se fond dans les accords du piano, les embrasse, s’éloigne, revient, caresse, frappe, taquine. Elle est vent, brise, souffle. Elle est le chuchotement d’un enfant à l’oreille de sa mère.
Nul ne saurait dire combien de temps ils ont joué. Le temps ne leur a pas dit. Trêve. Elle, n’a chanté qu’un refrain. Toujours le même. Les quelques mêmes mots, sur toutes les gammes, de la joie du coeur à la mort de l’âme.
Lorsque enfin, repus de sons, ils prennent congé de l’instrument, se rapprochent de l’âtre, du lit abandonné là, et que, silencieusement, ils s’enlacent, le temps, chaste, s’éloigne.
Ce matin, chez Natan, par la lucarne, deux personnes regardent les corbeaux lustrer leur plumage sur le toit de l’Eglise. Ils sont nus. L’Eglise ne leur en veut pas.
Ils viennent de jouer au piano, aux vocales, à l’amour.
Pêle-mêle sur le plancher, plus de partitions que jamais.
Des pages et des pages à quatre mains, deux écritures.
Une histoire d’amour en musique.
Leur vie commune.
Jouant à la marelle entre les tas de notes, Eve regarde son nouvel amour. En sautillant.
Un. Deux. Trois. Enfer.
– Ce jour là, tu ne disais pas au revoir à l’hiver, n’est-ce pas ?
– Non.
– Tu regardais les marchands de marrons.
– Oui.
– Tu les connaissais ?
– Du tout.
– Mais alors pourquoi ? Tu avais l’air si mystérieux. Si intrigué.
– C’est très rare, de voir partir ces gens-là.
Un. Deux. Trois. Paradis.
Elle le regarde. Le plus sérieusement du monde. Il tient son regard. Elle se dérobe. Soudain, un tremblement. Une fissure dans le masque serein de son visage. Frisson. Vague. Une mèche de cheveux cache la première secousse.
La seconde est trop forte. Elle éclate de rire.
– Je ne pensais pas que tu te moquerais de moi, réplique Natan, froissé.
Elle reprend son calme. Trop rapide pour le plus perfectionné des sismographes. Elle le toise. S’approche de lui. Lui met les mains sur les épaules. Soupire.
– Tu es très loin du compte mon chou. Je ne me moque pas de toi. C’est de moi dont je ris. C’était la raison de ma présence ce jour là. J’attendais le premier marchand de glaces.
Le visage de Natan revient au calme.
Sa main, tremblante une seconde auparavant, se lève, effleure le visage d’Eve. Le caresse, le souligne. Ses doigts tapent un accord sur sa joue droite. Une volée de note. Elle lui sourit.
Ensemble, ils regardent le lit.
Toute la gamme des charmes.
Une muraille. Une meurtrière. Une paire de jumelles. Quatre yeux. L’aube, superbe dans sa robe de rosée.
Eve. Irrésistible.
Natan. Admirateur.
Depuis une heure, ils font le guet. Attendant sur leur perchoir la venue d’un oiseau rare.
Au pied de la muraille, la Nouvelle Ville. A l’abri des murs, l’Ancienne Cité.
A sept heures trente-cinq, ponctuel, l’homme arrive. De là-haut, ils le voient venir de loin, lui et sa charrette à bras. C’est un de ces hommes sans âge, barbe grise et cheveux blancs, qui, suivant ses attitudes et ses vêtements pourrait être poète, avocat, chanteur, acteur, professeur de lettres, électricien, médecin, marin, philosophe ou dieu. Mais aujourd’hui, c’est dans sa tenue de marchand de glace, avec tous les accessoires et parfums inhérents à son poste qu’il est attendu.
Les amoureux le regardent avec l’émotion d’un touriste en safari découvrant, après des jours de poussière et d’attente les animaux sauvages venus s’abreuver au point d’eau, sous ces cieux sauvages où naissent les aubes.
– Cette fois, tu vas lui parler. Je te jure que tu vas lui parler, murmure Eve.
Natan tarde à répondre. Toujours la même peur. L’angoisse du rêveur à l’approche d’une réalité trop souvent imaginée.
– Tu ne veux pas y aller toi ? Tu me raconteras, réplique-t-il sans trop y croire.
– Jamais de la vie. On fait comme on a dit. Cet été, c’est toi. Cet hiver ce sera moi.
Résolu, le timide se lève, s’éloigne d’elle, se rapproche de la fatalité. Réalité.
Il descend les interminables marches d’escaliers, passe une porte autrefois dérobée, arrive au bas des murailles. Au pied du mur.
Sur la Petite Place, deux cafés, dont un ouvert, un manège, encore bâché, les caisses de fer d’un libraire, cadenassées, un balayeur, fatigué. Et le marchand de glaces. Premier artisan arrivé.
Assis à la terrasse ouverte, il attend patiemment un café que le serveur somnolent tarde à lui amener. Devant lui la presse du jour, ouverte à page gastronomie. Mine de rien, Natan s’installe à une table, pas trop proche ni trop éloignée. Les minutes passent. Le café n’arrive pas. Natan a la gorge sèche, serrée. De son perchoir, Eve observe les événements, lisant à l’aide des jumelles un article quelconque sur une révolution du concept de la cuillère à glace.
Natan attend. L’heure tourne. Le Marchand attend. L’heure tourne. Eve lit. L’heure a mal à la tête. Finalement le café arrive. Natan commande le sien. Eve attend que le marchand tourne enfin la page.
Dans sa barbe, le glacier maugrée :
– Je déteste qu’on lise par-dessus mon épaule.
Seul voisin, Natan, le prenant pour lui :
– Excusez-moi, c’est à moi que vous parlez ?
– Pas vraiment. Plutôt à votre copine, là-haut, la basanée aux petits seins qui zieute mon canard.
Natan, feignant l’innocence, un rien outragé :
– Je ne vois pas de quoi vous parlez, Monsieur.
– Écoute petit. D’abord, on n’appelle pas Monsieur quelqu’un qu’on passe son temps à mater. T’as déjà vu un ethnologue dire Monsieur aux gorilles. Vous m’avez tellement regardé, toi et ta grosse, que vous savez sûrement mieux que moi combien j’ai de pellicules et combien je vends de boules vanille par jour. Ensuite, je suis pas un animal rare qu’on observe. Je serais plutôt un vieux clébard, genre plein de puces et teigneux. Et là, tu t’es trop approché de la cage. T’es même rentré dedans. Alors si tu veux pas que je te morde, je te conseille de me foutre la paix. Et plus vite que ça. Allez, de l’air petit. De l’air !
Natan reste figé, tétanisé. Avant qu’il puisse ajouter un mot, le marchand le fusille du regard, une lueur sombre éclairant le fond de ses yeux. En un éclat de seconde, Natan peut lui donner un âge, une profession et un visage. Il est le faucheur d’illusions qu’il ne voulait jamais rencontrer.
Eve, dans sa sourde observation, n’a vu que les rictus, les lèvres sèches et brunes de nicotine de cet homme parlant au sien. Mais à la vue de Natan, de ses traits livides, de son corps immobile, la teneur des mots ne fait aucun doute.
Eve tremble.
Lui n’attend pas son café. Ne répond rien. Ne pense même pas à s’excuser ou à se justifier. Il s’enfuit. Ne remonte pas les marches d’escaliers. Ne rejoint pas son amour. Part dans la direction opposée, vers la Rue Principale, son Eglise et ses toxicomanes.
Eve le suit du regard. Il marche si vite qu’elle n’a pas le temps de régler la netteté. Elle le voit partir, flou.
Revenant sur le marchand, elle se rend compte qu’il l’observe.
Sur son visage, plus de rictus, plus de nicotine. Dans ses yeux le jeu.
Il lui fait signe de la main comme on salue un ami lorsque le train entre en gare.
Eve pleure.
Le soir est tombé. Un groupe de vieux enfants s’oublie sur les marches de l’Eglise. Sur leurs membres une carte du ciel. De petites étoiles infectées de sang séché. Astres de l’oubli. Dans leurs yeux, le vide. Il n’y a personne dans ces corps. Juste le manque. Pas d’envies. Pas de vie. Pas d’amour. Le soir est tombé. Ils ne s’en sont pas rendus compte. La nuit coule dans leurs veines. Continuellement. En circuit fermé. Fauchés.
Âme, drame, gramme, pique et pique et colle et gramme, c’est la drogue qui te gagne.
Dans l’Eglise, effondré sur un banc, Natan se repaît de silence. Triste.
Il hésite à ressortir comme il est venu, en zombie. Aller sur le parvis rejoindre ceux qui s’en sont allés. Sortir une liasse de billets de sa poche, l’échanger contre une poudre aux relents de caramel. Puis la fumer. Ou l’injecter. Qu’importe ! Mais fuir enfin la réalité. Fuir ce monde. Vite.
Dans l’Eglise, effondré sur un banc, Natan tremble. Peur.
Dans sa tête fuient des images. De mauvaises images. Violence. Passion. Mort. Suicide. Destruction. Meurtre. Tout ce que sa vie a pu comporter d’absurde lui saute aux yeux. Ses plus beaux souvenirs se transforment en images de sang, de désolation, souffrance. Tant de bruit dans sa tête. Plus aucune ligne mélodique. Plus de rêves. Seulement la réalité, dans son habit le plus strict.
Am stram gram Pic et Pic et colegram, c’est l’enfer qui te gagne. Pif paf pouf c’est la vie qui te bouffe.
– Personne n’a dit que ce serait facile Natan, souffle, légère, une voix dans son dos.
Natan se retourne, les yeux rougis de larmes qu’il n’a pas même senti couler. Honteux d’entendre son nom prononcé. En face de lui, une femme. La dernière qu’il imaginait rencontrer ici. Sa professeur de musique.
– Que voulez-vous Professeur Damato ? s’enquiert-il.
– Tu le sais mieux que moi. Je t’ai bien vu regarder les drogués. Tu as hésité, n’est-ce pas ?
– Oui. C’est vrai. Quoi de plus naturel ? La vie n’est pas belle. Elle est sale. Je ne veux plus la voir. Tout comme je ne tiens pas spécialement à vous voir. Vous n’avez rien à faire dans mon cauchemar. Retournez à votre place, dans le passé. Repartez dans l’adolescence de mes souvenirs et foutez-moi la paix, professeur.
– Tu m’as l’air un peu énervé Natan. Être aigri à ton âge, c’est du luxe. Moi je peux, si tu veux. J’ai quarante-cinq ans, je suis célibataire, mes élèves ne sont pas des gens connus. Je ne suis pas connue. J’ai passé toute ma vie à apprendre la musique aux gens sans être capable de créer quelque chose. Et le dimanche, je croise mes élèves les plus doués hésitant à se droguer, avachis sur un banc d’église en priant l’autodafé. Tu exagères. Vraiment. C’est quoi ton problème ?
Décontenancé, Natan l’observe. Il est en colère. Il le sait. Et ça l’énerve.
– Écoutez, Madame Damato, vous avez toujours prétendu m’aider. Vous m’avez poussé à créer de la musique. Vous m’avez dit, mille fois, qu’il faut la comprendre pour savoir l’écrire, que le solfège n’était qu’une langue de plus, universelle, et cætera et cætera. Vous m’avez bourré le mou avec vos salades pendant des années, et là, tout ce que vous trouvez à me raconter, c’est que vous-même ne savez pas créer. Mais à quoi bon créer Madame, à quoi bon. On ne peut pas créer dans un monde sans poésie. Ce monde est dur. Ce monde me rend fou. Il est imperméable à la beauté. Jamais plus je ne toucherai un piano. Ou alors si, avec une boîte d’allumettes.
– Excuse-moi Natan. Je pensais que tu avais passé ta crise d’adolescence. Je ne te dérangerai pas plus longtemps. Bonne journée.
Elle se lève, marche vers l’autel, fait un signe de croix, puis s’en retourne, repasse devant Natan, ne le regarde même pas, se dirige vers la sortie, sort.
Abandonné là, Natan rumine sa colère. Il regarde l’autel, la haute croix, l’homme cloué dessus. Il le regarde dans les yeux. L’homme pleure. Depuis deux mille ans. Natan ne veut pas pleurer aussi longtemps.
Il se lève. Marche sous les hautes voûtes parsemées d’anges joufflus, de vierges éternelles et de démons vaincus. Marche. Fait le tour. Compte les bancs. A chaque tour, sa colère s’apaise, se transforme. Il marche. Encore. Deux heures passent.
Natan pense aux démons, à la vierge, aux joues des anges. La religion n’a jamais été son fort. Le Dieu des chrétiens est absent depuis trop longtemps. Et ses enfants ont fait beaucoup trop de morts pour se persuader de son existence. Mais peu à peu, à tourner dans l’Eglise comme le lion dans sa cage, son jugement change. Le calme de l’endroit l’envahit. Changement de point de vue. Ce n’est pas Dieu qu’il rencontre, mais l’homme. L’humanité. Ces milliers de gens, des siècles durant, réunis ici par le besoin d’être ensemble. Peu importe le motif. Réconciliation.
Il s’arrête soudain au milieu de l’allée. Regarde l’homme sur sa croix. L’homme pleure. Mais il n’est pas triste.
Alors Natan, dans un élan, se met à courir, fait le tour de l’autel, voit une porte, l’atteint, l’ouvre. Son coeur s’accélère. Derrière, un escalier en colimaçon. Il s’y précipite. Court. Court. Court. Court. Court. S’essouffle. Court. Court. S’essouffle. Marche. Éreinté, il atteint une autre porte. Après deux cent dix-sept marches. Une ouverture. Un entrebâillement.
Du dehors souffle un vent léger.
Natan est au sommet de l’Eglise et Dieu, au loin, sourit.
Cela naît. Doucement d’abord. Des tréfonds. En un endroit inconnu de la géographie humaine. Quelque part entre le coeur et l’âme. Infinitésimal. Cela existe. Comme une particule prend vie. Comme un embryon devient fœtus. Premier battement de coeur. Cela se transforme, grandit. De plus en plus vite. De plus en plus grand. Cela prend forme. Puis cela veut sortir.
Cela veut naître. Cela naît.
Natan crie.
Seul, au sommet de la tour. Au sommet de l’Eglise. Au sommet du monde.
Natan regarde au-dessous de lui, au-dessus, au-delà.
En criant. De toute la force de son âme retrouvée.
La réalité, dans chaque pierre, chaque nuage, chaque recoin de son horizon redevient charmeuse, colorée.
Natan vit.
Enfin.
Alors que Natan, du haut de sa tour, flirte avec sa renaissance, Eve, sur la Petite Place, mange une glace.
Son regard se perd sur les traits des autres gourmands, choisissant dans la longue liste de douceurs leurs pêchés favoris. De fines gouttelettes salées perlent de ses yeux, se perdent sur les tristesses de son visage et se meurent sur ses lèvres.
– Je ne vends pas de ce parfum, mademoiselle, avertit le marchand de glaces, la voyant pleurer sur son cornet comme d’autres se lamentent sur leur bière. Vous ne devriez pas être triste. Mes glaces ne sont pas si mauvaises.
Elle lui répond un sourire contrit. Une coulée pistache s’échappe de son bricelet.
– Vous lui avez fait peur, n’est-ce pas, demande-t-elle enfin, timide ?
L’homme ne répond pas. Il a reconnu la compagne du voyeur. Il sert les derniers clients agglutinés autour de sa boîte à fraîcheur. Ferme boutique. Met l’écriteau “De retour dans cinq minutes…”, tend le bras à Eve. Elle le prend. Il l’emmène au café. En commande deux. Puis, finalement:
– Oui ma chérie. Je lui ai fait peur. Parce que vous lui avez menti.
– Absolument pas. Il voulait vous rencontrer alors je l’ai poussé à venir vous parler, c’est tout. Je n’ai rien dit d’autre, rétorque-t-elle, défensive.
– Si. Vous lui avez fait croire que vous croyiez en moi. Or ce n’est pas vrai. Vous ne croyez qu’en lui. Ce qui est, je le concède, bien plus honorable.
Le serveur survient. Pose les tasses. S’en va. Répit. Le glacier, consciencieusement, ouvre son sachet de sucre, le verse. Fait de même avec le pot de crème. Cérémonie. Dans la tasse, le blanc se mêle au brun, magie du métissage. Son regard, sous le dru duvet de ses sourcils, se promène de la boisson à la jeune fille. Il attend sa réaction. Patient.
Elle, son café, elle le fixe. Mais elle n’y voit rien. Elle s’y cache. Furtivement, elle sonde l’homme assis en face. Il a encore changé. Sa physionomie reflète à présent l’idée que Natan, dans ses rêves, devait se faire du Grand Marchand de Glace, mystérieux et poète, un peu fou et génial. Transformation. Mutation.
Il la regarde ne pas le regarder. Tout sourire. Espiègle.
– Il ne voulait que vous rencontrer, répète-t-elle, la voix hésitante. Et puis, croire en quoi ? En un marchand de glaces ? Je ne vois pas ce que ça a de particulier. Vous êtes quelqu’un qui vend des glaces. Rien de plus.
– Et rien de moins. Mais ce n’est pas à moi qu’il faut dire ça. N’avez vous pas vu ses yeux. Il me regardait comme on lit un livre de légendes. Il ne me voyait pas, ne m’aurait pas entendu. Son imaginaire lui bouche les yeux. Il confond rêveries et lunettes noires. L’imagination est le parent pauvre de la réalité. Dites-le-lui, Mademoiselle. Un parent pauvre. Un bâtard. Et vous, Mademoiselle, avez donné à ses rêves une attache dans la réalité. Vous avez épousé ses chimères. Pour lui plaire. Vous êtes une muse bien cruelle. L’Amour n’a rien d’une concession. Vous ne gagnerez rien à le perdre.
– C’est à ma vie privée que vous parlez, Monsieur le glacier. Et elle n’a pas envie de vous répondre. Vous divaguez. Qu’est-ce qui peut bien vous faire déduire tout ça ?
– Ne vous emballez pas voyons. Je ne fais qu’observer. Rien de plus. Mon travail m’offre un vaste panorama du genre humain. Et vendre de la fraîcheur aux gens, leur prêter l’oreille entre deux bricelets, est une noble cause. Ne vous méprenez pas. On peut beaucoup aider en écoutant.
– De toute façon, vous m’avez volé mon Natan. Il est parti. Je ne suis même pas sûre de le retrouver. Il serait capable de se perdre dans son appartement tellement il a la tête en l’air. Vous me l’avez cassé.
– Bah ! Ce n’est pas un jouet Mademoiselle. C’est un être humain, de la catégorie des sensibles. Je lui ai juste botté le cul, s’exclame, rieur, le Marchand. Je lui ai remis les idées en place. C’est une bonne médecine. Un peu spartiate mais efficace. Allez le retrouver maintenant, et dites-lui que je n’existe pas. Pas comme il le croit. Ni moi ni les autres. Il n’y a rien de mystérieux dans le fait de vendre des douceurs aux gens. C’est un pêché de gourmandise transformé en profession de foi, pas une croisade ni un Grand Œuvre.
Eve paie le café. Remercie l’homme. Celui-ci repart à sa charrette, retire l’écriteau, se remet au travail.
Eve ne se sent pas mieux. Rentre. Mais pas chez lui.
Le marchand de glace, la voyant partir, susurre, pour lui-même :
– Patience ma belle, patience, l’hiver viendra.
L’été passe. L’automne vient. Plus vite que de coutume pensent les gens. Une grande vague de froid. Une déferlante. Dans les salons de thé, des vieillards nostalgiques lisent des catalogues de voyages aux couvertures glacées saturées de palmiers et de beautés déshabillées de fleurs. Dans la Rue Principale, un cortège ininterrompu de longues limousines blanches se dirige vers le sud. Aux portes de la ville, pas un seul oiseau pour les saluer. Ils sont déjà partis. Les traditions ne survivent pas au mercure.
L’automne est pressé cette année. On le voit courir partout, un pinceau à la main, grognant et peignant à tous vents la nature et les gens, laissant derrière lui des brouillons morts tomber des arbres. Pressé. Les poètes en oublient de porter leurs écharpes rouges. Pressé. Les jours s’accélèrent. Les nuits raccourcissent. Les astrologues paniquent. Trois semaines consécutives ne durent que six jours.
Puis soudain arrive l’hiver, hilare dans son manteau de fourrure à la pensée de sa venue anticipée. D’un coup de gel il boute l’artiste hors de scène, s’installe.
Il a à présent tout son temps pour vernir le tableau inachevé abandonné par son prédécesseur.
Le tableau est triste. Les gens ont froid.
Eve et Natan également.
Eux plus que les autres.
Séparés.
Depuis son retour de l’Eglise, Natan ressent le besoin d’apprendre, d’étudier. Il s’est fait livrer deux bibliothèques en chêne massif aux rayonnages desquels viennent quotidiennement s’ajouter des ouvrages.
Le sol est propre. Dans un coin, près de la cheminée, une pile de partitions attend, résolue, d’être conduite au bûcher.
Sur les touches de son piano une fine couche de poussière.
Assis sur son tabouret, Natan lit. Serein.
Son visage a changé. D’imberbe il est devenu barbu. Une paire de lunettes aux fines montures dorées repose le vert fragile de ses yeux.
Natan sait à présent que pour comprendre le monde il lui faut le cerner. Il ne perd plus son temps à jouer du piano.
En une seule saison, il a dévoré plus de livres que durant toutes ses études. Science. Histoire. Économie. Géopolitique. Et maintenant, l’ornithologie. Nouveau sujet. Nouvelles nuits blanches.
Avant, les oiseaux, il les écoutait. Se laissait bercer de leur chant, suivait leurs longues conversations. Parfois même, il en était un, s’envolait par-delà les villes, regardait le soleil se lever, ses petites pattes confortablement calées sur un perchoir télégraphique, se laissait planer au-dessus des forêts, goûtant la rare sensation du vent chatouillant son plumage.
Maintenant, les oiseaux, il les classe en familles. Il les étudie, les répertorie.
Natan n’est pas triste.
Natan n’est pas gai.
Il est de plain-pied dans sa nouvelle réalité.
D’Eve il n’a gardé qu’une photo.
Elle est au sommet de la pile de partitions.
Parfois, Natan verse une larme, alors il va à la lucarne et la ferme, pensant qu’il a pris froid. La tristesse n’est pas au programme de sa nouvelle vie.
Natan veut oublier. Oublier sa vie d’avant. Futile.
Sur le toit de l’Eglise, les oiseaux se moquent de lui.
Il ne les entend pas, sa lucarne est trop souvent fermée.
Et puis, un oiseau, ça ne peut pas se moquer.
Un oiseau, ça n’a pas d’âme.
Mais les oiseaux ne le savent pas.
Depuis cette journée d’été, Eve vit avec sa mère. Tous les dimanches, à l’heure du thé, la fille s’essaie aux confidences. Habituellement, la mère l’écoute d’une oreille distraite en peignant Isidor, un majestueux persan au poil aristocratique. Mais aujourd’hui, le chat n’est pas là – allez savoir pourquoi – et ce sont les soucis de sa fille que d’une oreille attentive elle tente de démêler.
– Eve ?
– Oui maman ?
– A quoi penses-tu ?
– A lui bien sûr. A quoi veux-tu que je pense ?
– A toi.
La mère s’approche de la fille. La fille pose sa tête sur ses genoux. La mère lui brosse les cheveux.
– C’est la même chose. Il est la partie de moi qui me manque.
– Alors va le voir.
– Je ne peux pas. Il doit croire que je me suis moquée de lui, que je l’ai amené dans un piège. Il ne me le pardonnera jamais
– Pourquoi as-tu fait ça ?
– Pour le séduire. Je lui ai montré ce qu’il voulait voir. Je ne croyais pas à ses délires. Comment pourrais-je ? Tu en connais beaucoup, toi, des hommes qui disent au revoir à l’hiver ? Ce n’est pas possible. Ca n’existe pas. Mais… il joue si bien… et il me fait si joliment l’amour…
La mère arrête de brosser. Elle regarde longuement sa fille.
– On ne laisse pas partir un homme qui fait l’amour ainsi, Eve. On lui fait un enfant.
 Découvrez encre et notes pour un voyage dans les univers mêlés de Yann L et de DProjekt
Découvrez encre et notes pour un voyage dans les univers mêlés de Yann L et de DProjekt